Justice sociale et écologie politique : quel horizon commun ?
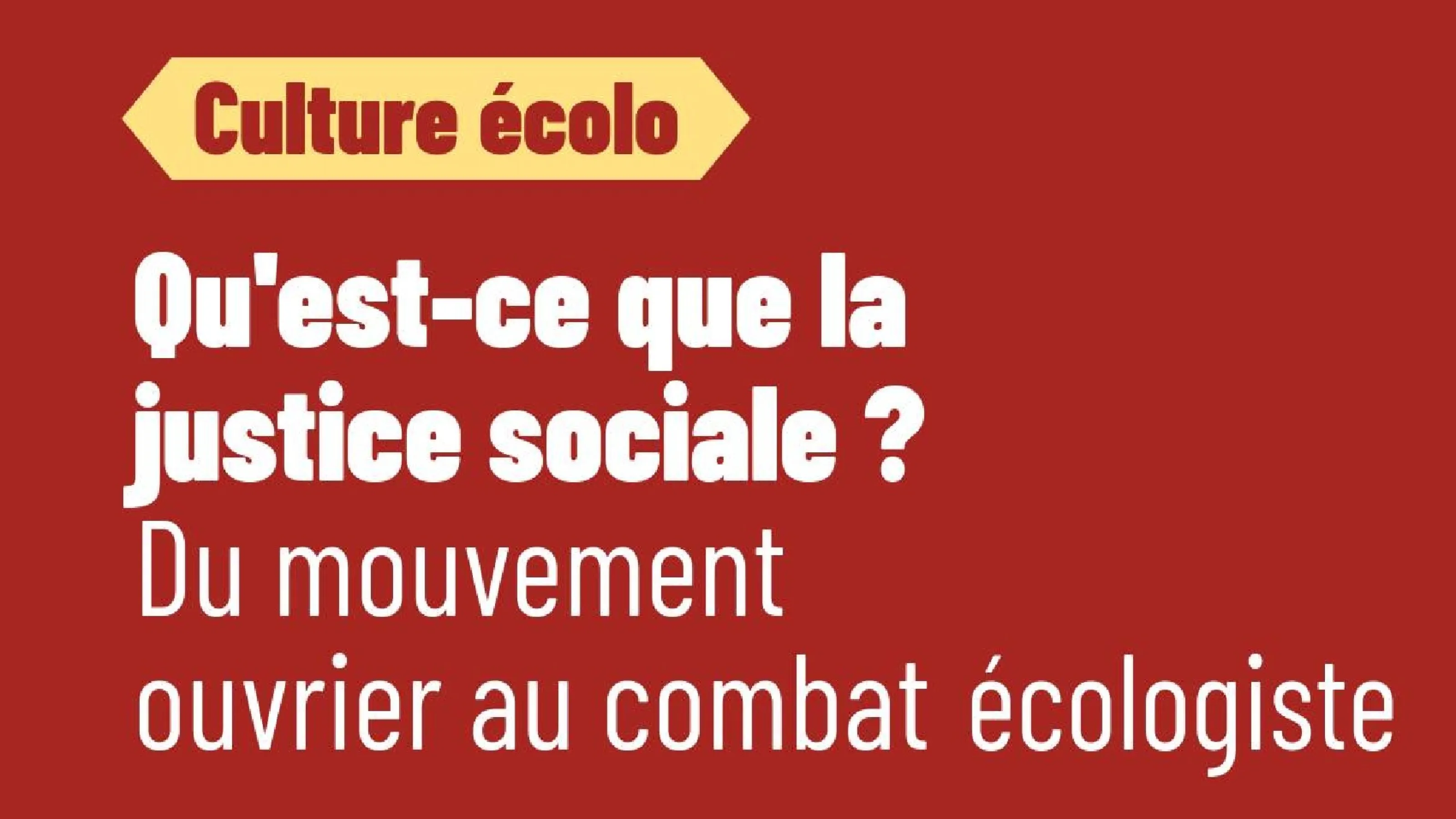
La justice sociale constitue l’une des réponses historiques à la "question sociale", surgie en Europe au XIXe siècle avec la Révolution industrielle : comment organiser une société qui garantisse la dignité de chacun face aux inégalités, à la pauvreté et à l’exploitation ?
Née dans les luttes du mouvement ouvrier, nourrie aussi par des courants réformateurs, associatifs et confessionnels, la justice sociale est devenue au fil des décennies un principe structurant de nos sociétés démocratiques. Elle s’est traduite par des conquêtes concrètes : protection sociale, droit du travail, éducation publique, services collectifs, sécurité sociale, défense des "communs"… autant de dispositifs conçus pour sécuriser les trajectoires de vie, réduire les vulnérabilités, protéger contre l’arbitraire.
Mais la justice sociale reste un combat permanent, car les inégalités se recomposent, la pauvreté persiste et de nouvelles formes de précarité apparaissent : ubérisation, isolement des travailleurs indépendants, insécurité résidentielle, fragilisation des parcours de jeunesse, discriminations systémiques, précarité alimentaire…
🎯 La justice sociale implique une démarche plus large que la seule lutte contre les inégalités : il s’agit de reconnaître à chacun la capacité réelle à participer pleinement à la vie sociale, économique, politique et culturelle. Elle comporte une dimension éthique, mais aussi structurelle, en ce qu’elle interroge la manière dont les institutions, les normes ou les rapports de pouvoir entravent cette participation.
Les théoriciens de la reconnaissance – Axel Honneth et Nancy Fraser notamment – ont souligné que les injustices ne sont pas seulement des écarts quantifiables, mais aussi des atteintes au statut de pair, des formes d’invisibilisation, d’humiliation ou d’exclusion. Pour Honneth, c’est l’expérience morale de l’injustice qui fonde la revendication sociale. Pour Fraser, ce sont les structures sociales – économiques, culturelles, institutionnelles – qui doivent être mises en cause lorsqu’elles empêchent certains groupes de compter dans l’espace public. Structures de genre, domination raciale, mépris de classe : la justice sociale exige de faire tomber les barrières à la reconnaissance et à la représentation.
🌱 À ces dimensions économique et culturelle s’ajoute désormais un impératif environnemental : comment participer à la vie sociale quand son quartier est surexposé aux pollutions, quand son logement devient invivable en été, ou quand les arbitrages budgétaires réduisent l’accès aux transports ou aux soins ?
Le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, la dégradation des milieux de vie frappent d’abord les plus vulnérables. Dans cette perspective, l’écologie politique a une responsabilité particulière : assurer que la transition écologique ne soit pas un facteur de fracture supplémentaire, mais un levier de justice.
Car une transition qui alourdit les charges des plus modestes, qui exclut des territoires, qui sacrifie les plus fragiles, est une transition injuste. À l’inverse, une transition qui lutte contre la précarité énergétique, qui améliore les logements, qui crée de l’emploi utile et non délocalisable, qui densifie l'offre des mobilités décarbonées, qui renforce les services publics et le lien social, peut être un moteur de justice sociale et de résilience collective.
👥 Aujourd’hui, dans un contexte de crises écologiques, sociales et démocratiques, la justice sociale est à la fois une exigence éthique, une boussole politique, et une condition de cohésion. Elle oblige à penser ensemble les droits et les moyens d’y accéder, les protections et les pouvoirs d’agir, les réparations et les transformations.
C’est ce projet que porte une écologie politique populaire et exigeante : non pas gérer l’injustice, mais la combattre à la racine.




