Comprendre la décroissance pour se réapproprier la notion de progrès humain
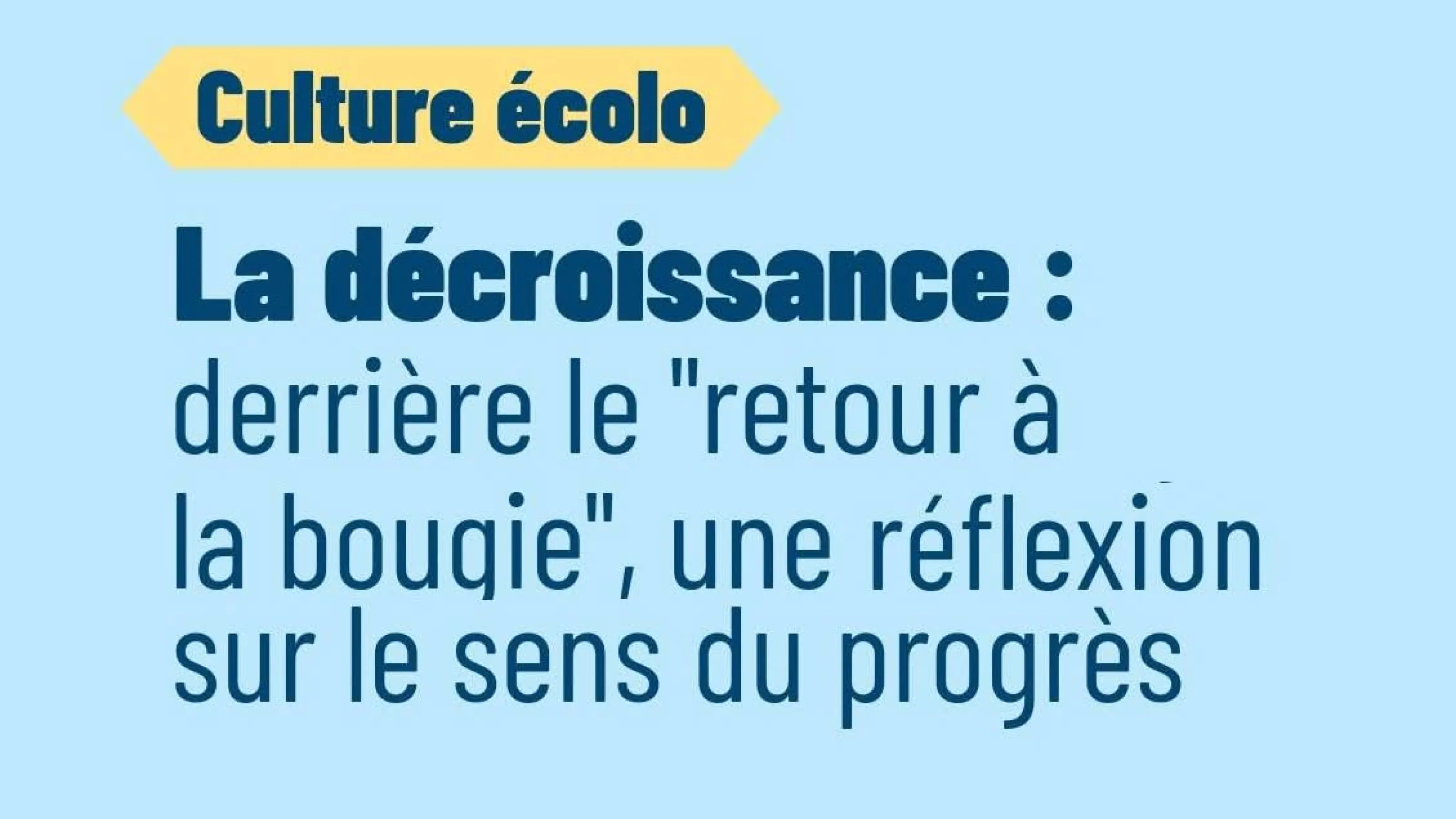
C’est un mot qui fait peur, tant il remet en cause les fondements de nos sociétés contemporaines. La décroissance est souvent caricaturée comme un "refus du progrès" ou un "retour à la bougie". Elle constitue en réalité une pensée exigeante, née d’un long travail critique sur l’économie, la technique, l’écologie et le sens de nos vies.
Dès les années 1930, l'économiste hongrois Karl (Károly) Polányi pose les bases d’une remise en cause du capitalisme industriel en montrant comment l’économie de marché, en se désencastrant des sociétés humaines et des équilibres naturels, a généré une forme d’anarchie sociale. Il s’inquiète déjà des dégâts qu’une logique purement marchande inflige aux solidarités, aux territoires et aux équilibres écologiques.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, d'autres voix s’élèvent contre l’illusion du progrès sans limites : Jacques Ellul et Bernard Charbonneau dénoncent une société qui, au nom de la technique et de l’efficacité, sacrifie la liberté et la lenteur. Leur critique de la "mégamachine" anticipe ce que nous vivons aujourd’hui : un monde saturé de vitesse, de dépendances technologiques et de déracinement. Ce déracinement n'est pas identitaire : il révèle une série de ruptures entre le monde physique et sensible, et nos modes de vie (perte des mémoires locales, abstractisation des saisons, rupture du lien entre production et consommation).
Dans les années 1970, le débat bascule. Le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome, introduit dans l'arène publique la notion de "limites planétaires" : croître indéfiniment dans un monde fini conduit mécaniquement à l’effondrement. Cette prise de conscience s’appuie sur les travaux pionniers du Roumain Nicholas Georgescu-Roegen, père de la bioéconomie, qui applique les lois de la thermodynamique à l’économie : toute production implique une dégradation irréversible d’énergie et de matière. Ce n’est plus une question d’opinion, mais une loi physique : la croissance infinie est un non-sens.
C’est dans ce contexte qu’André Gorz, philosophe socialiste, figure centrale de l’écologie politique, introduit le terme "décroissance" dans le débat français. Il ne s’agit pas pour lui d’un programme de privation, mais d’un projet de reconquête : retrouver du temps, de l’autonomie et du sens. Il voit dans la société de croissance une machine à produire du mal-être, à aliéner les individus dans des rythmes absurdes, à couper les liens humains au nom de la productivité. La décroissance est alors étroitement liée à la pensée émancipatrice de la gauche et à la critique de l'avènement d'une société de la consommation.
Pendant ce temps, Ivan Illich développe une critique radicale des institutions industrielles : santé, éducation, mobilité… tout devient "contre-productif" à partir d’un certain seuil de développement. Il plaide pour une société conviviale, où les outils sont à la mesure des humains, et non l’inverse.
Dans les années 1980-1990, les objecteurs de croissance prolongent cette critique dans un monde désormais globalisé, financiarisé, saturé de marchandises et d’écrans. François Partant déconstruit le mythe du développement, en montrant que les modèles imposés au Sud ne font que reproduire les logiques extractivistes et destructrices du Nord.
Le mot "décroissance" prend sa connotation polémique dans les années 2000, grâce notamment à Serge Latouche, qui en fait un mot-clé, une provocation salutaire, un "mot-obus" une "évidence hérétique". Il ne s’agit pas de faire la même chose en plus petit, mais de sortir du culte du "toujours plus". Il cherche à changer nos imaginaires, à remettre la vie, la beauté, le soin, la coopération, la nature, au centre de nos sociétés. L'écologiste Cécile Duflot est la première députée à parler de décroissance à l'Assemblée nationale à la fin des années 2000.
Aujourd’hui, la décroissance irrigue les pensées féministes, les luttes pour la justice climatique et les démarches locales de transition écologique. Elle parle de sobriété, mais aussi de dignité, d’émancipation, de solidarité. Elle interroge la place du travail, le sens du progrès, les rapports Nord-Sud, les frontières entre nature et culture. Des autrices et auteurs comme Geneviève Azam, Jason Hickel, Timothée Parrique ou Yves-Marie Abraham en renouvellent les formes et les alliances, en dialogue avec les voix du Sud, qui rappellent que la soi-disant "abondance" occidentale repose sur la spoliation des autres.
La décroissance invite certes à un pas de côté, mais surtout à une critique frontale d’un modèle fondé sur la démesure, l’extraction, la vitesse et l’inégalité. Elle ne prône pas la fin de toute activité, mais pose cette question essentielle : que voulons-nous produire ? Pour qui ? À quel prix écologique et social ? Et au service de quelle idée collective d'une vie bonne et heureuse ? L'enjeu du combat écologiste n'est pas tant de "provoquer la décroissance" comme une fin en soi, mais d'anticiper et de civiliser l'inexorable déclin de nos modèles fondées sur des ressources finies, c'est faire en sorte que la décroissance ne soit pas sauvage, au profit des plus riches, mais qu'elle se fasse dans la justice sociale, une notion abordée précédemment.

