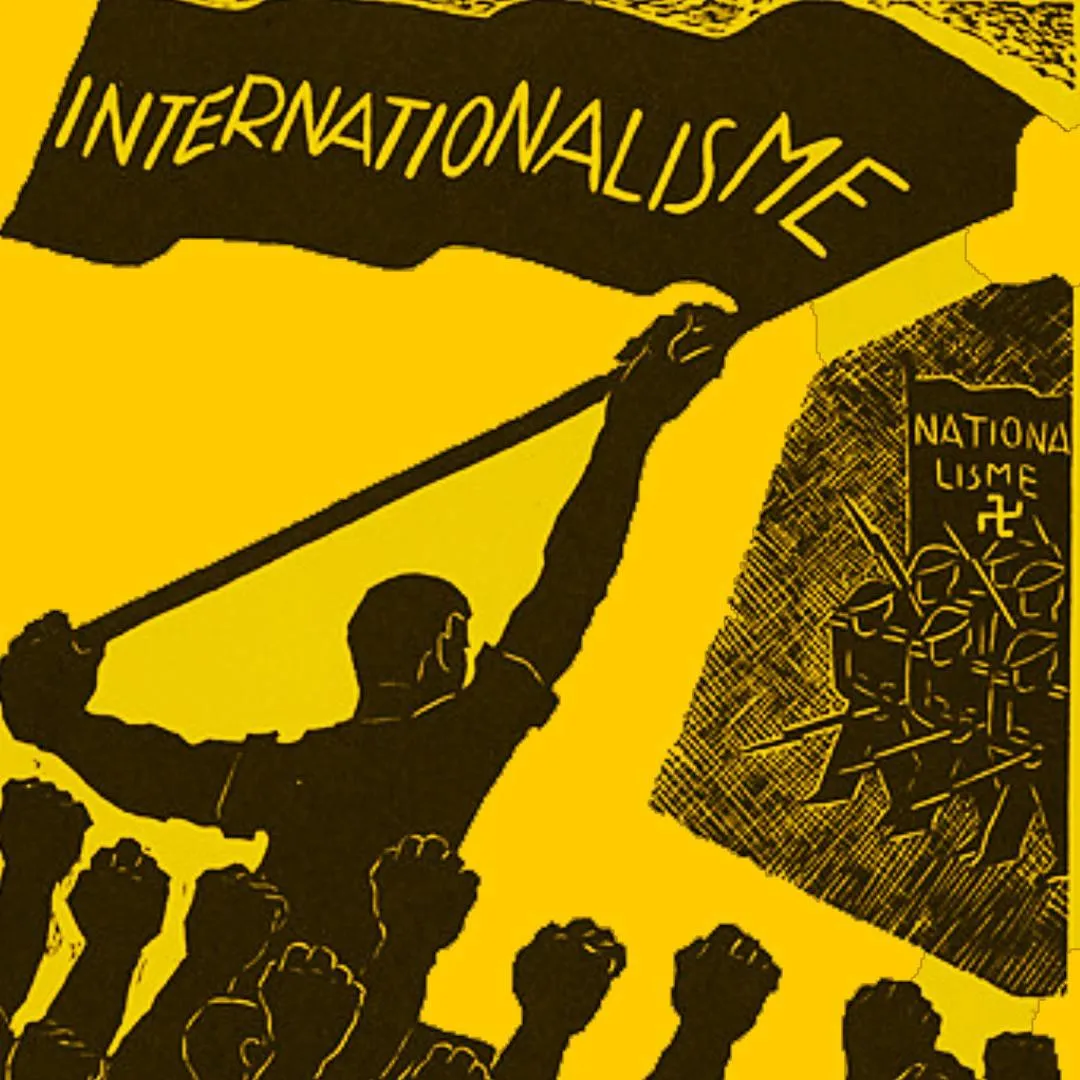Agir local, penser global : de l'internationalisme à l'engagement altermondialiste
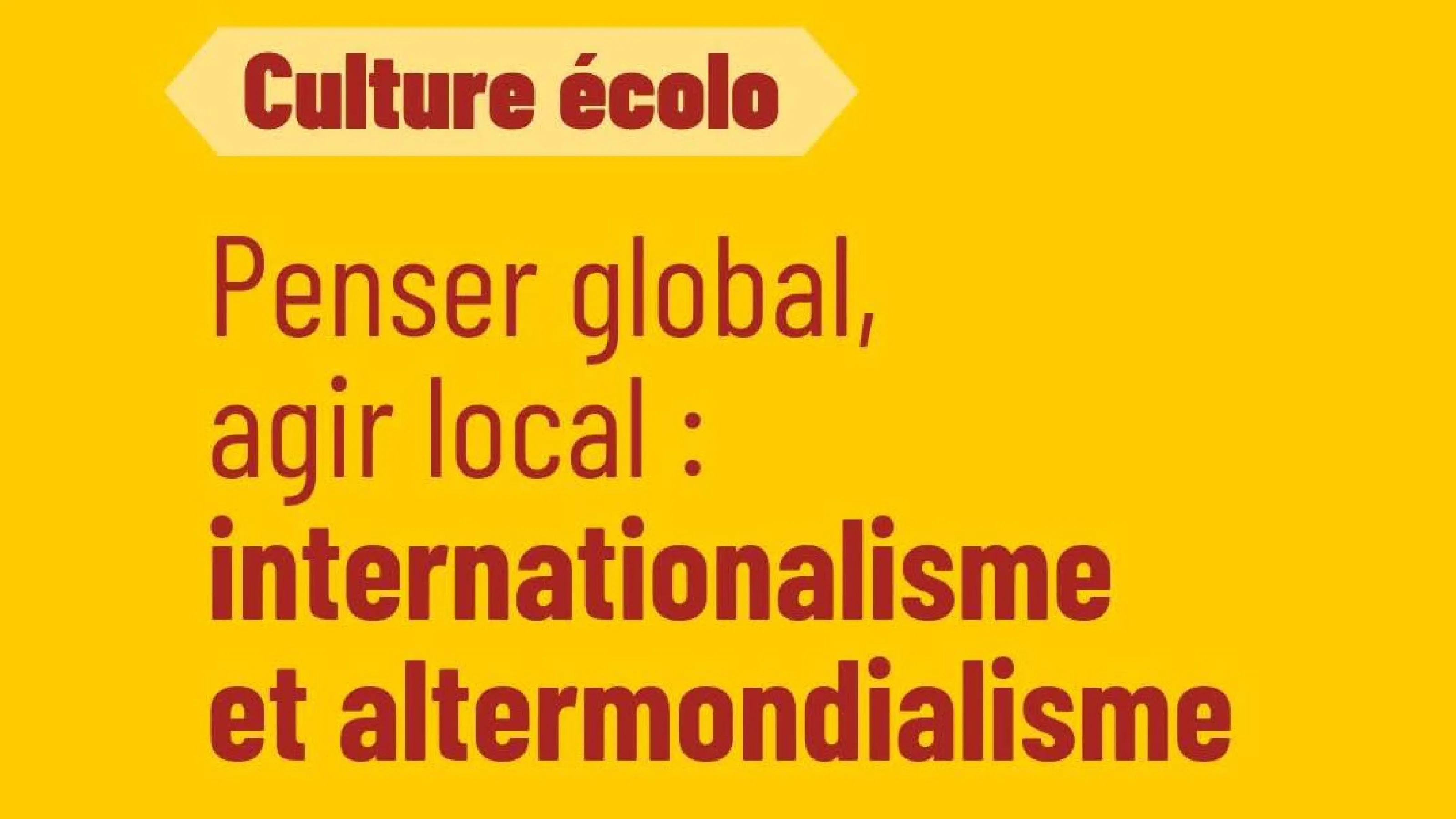
L'écologie politique s'est construite sur un constat : les grands déséquilibres écologiques — pollution, changement climatique, épuisement des ressources, disparition des espèces — dépassent largement les frontières nationales.
Elle pose des ponts, dès les années 1960–1970, avec la tradition internationaliste du mouvement ouvrier forgée au XIXᵉ siècle par les courants marxistes. L'internationalisme ne relève pas seulement d'un sentiment de solidarité mondiale : il vise à structurer la fraternité des travailleurs au-delà des logiques étatiques issues du capitalisme industriel.
Cette convergence s'observe à travers des luttes ouvrières et syndicales en Europe et en Amérique du Nord, souvent à la suite de catastrophes industrielles (Feyzin, Seveso, Three Mile Island) ou de mobilisations antinucléaires. Ces expériences contribuent à faire émerger ce que certains appellent un environnementalisme ouvrier, qui rapproche les préoccupations des salariés exposés à des conditions nocives et celles des habitants affectés par les pollutions.
On y retrouve l'idée de réconcilier le travailleur-producteur et le citoyen-consommateur, en refusant que la santé publique et la protection des écosystèmes soient réduites à de simples variables d'ajustement dans le compromis fordiste triomphant.
Avec la mondialisation néolibérale des années 1980–1990, le centre de gravité se déplace en dehors de la sphère occidentale. Les délocalisations industrielles et le pillage des ressources agricoles par les grandes firmes américaines et européennes suscitent des mobilisations paysannes et ouvrières dans les pays du Sud, comme le Mouvement des sans terre au Brésil, dont les luttes acquièrent une portée internationale. C'est l'époque de l'altermondialisme, qui prend forme dans les forums sociaux mondiaux (Porto Alegre, Mumbai). Ces espaces deviennent des lieux de rencontre et de coordination entre paysans, syndicalistes, écologistes, féministes et militants du Nord comme du Sud.
L'altermondialisme prolonge la tradition internationaliste en affirmant qu'une autre mondialisation est possible : plus démocratique, plus juste, et respectueuse des équilibres écologiques. C'est dans ce contexte qu'est publié, en 2001, le premier manifeste écosocialiste, qui articule transformation sociale et transition écologique à l'échelle internationale, sans pour autant déboucher sur la création d'une nouvelle "Internationale" au sens classique du mouvement ouvrier.
Dans les années 2000–2010, l'altermondialisme contribue à faire émerger un agenda politique international, relayé nationalement par la plupart des partis de gauche et écologistes. Cet agenda inclut des mécanismes mondiaux de lutte contre les inégalités et des instruments fiscaux innovants pour financer une transition écologique et sociale globale : allègement ou annulation de la dette des pays pauvres, taxe Tobin sur les transactions financières, etc.
La succession de crises depuis le début du XXIᵉ siècle — crise financière, pandémie de COVID-19, intensification des conflits armés aux portes de l'Europe — a confirmé nombre d'analyses portées par les altermondialistes. Mais elle n'a pas débouché sur un renforcement durable des mobilisations sociales et écologistes à l'échelle planétaire.
Celles-ci demeurent fragmentées et peinent à se structurer dans un paysage global de plus en plus instable. Des mouvements comme Occupy ou les Indignés, dans les pays occidentaux, ont cherché à prolonger les contestations populaires du Printemps arabe ; les Fridays for Future, initiés par Greta Thunberg, ont placé l'urgence climatique au cœur du débat public. Mais ces dynamiques restent inégalement réparties, surtout concentrées dans les pays du Nord.
Aujourd'hui, plusieurs obstacles freinent l'émergence d'un mouvement global : la répartition inégale des efforts face au dérèglement climatique, les tensions Nord–Sud, la montée de l'extrême droite qui fragilise les consensus sociaux autour de la transition écologique, et l'émergence d'un ordre mondial incertain où cette transition devient aussi un enjeu géopolitique.
Dans ce contexte, la formule "penser global, agir local" conserve toute sa force, à condition d'être abordée avec davantage de complexité. Les actions locales — protéger un écosystème, défendre des droits sociaux, inventer des alternatives énergétiques — n'ont de sens que si elles s'articulent à une perspective plus large, qui tienne compte des inégalités planétaires et des recompositions géopolitiques.
✊ L'internationalisme s'est incarné dans les mobilisations syndicales et la solidarité concrète des travailleurs par-delà les frontières. L'altermondialisme a prolongé cet héritage en réunissant paysans, syndicalistes, écologistes et féministes pour affirmer qu'une autre mondialisation était possible.
Aujourd'hui, l'écologie politique reprend, avec d'autres, ce fil : relier les combats locaux à une perspective de gouvernance mondiale plus démocratique, réinventer un multilatéralisme écologique et solidaire, et esquisser les bases d'un fédéralisme mondial pour affronter les enjeux globaux. C'est dans cette circulation permanente entre ancrage local et horizon global que peut s'affirmer une écologie politique prête à transformer en profondeur notre modèle économique et social.