L'agriculture paysanne : produire autrement, vivre dignement
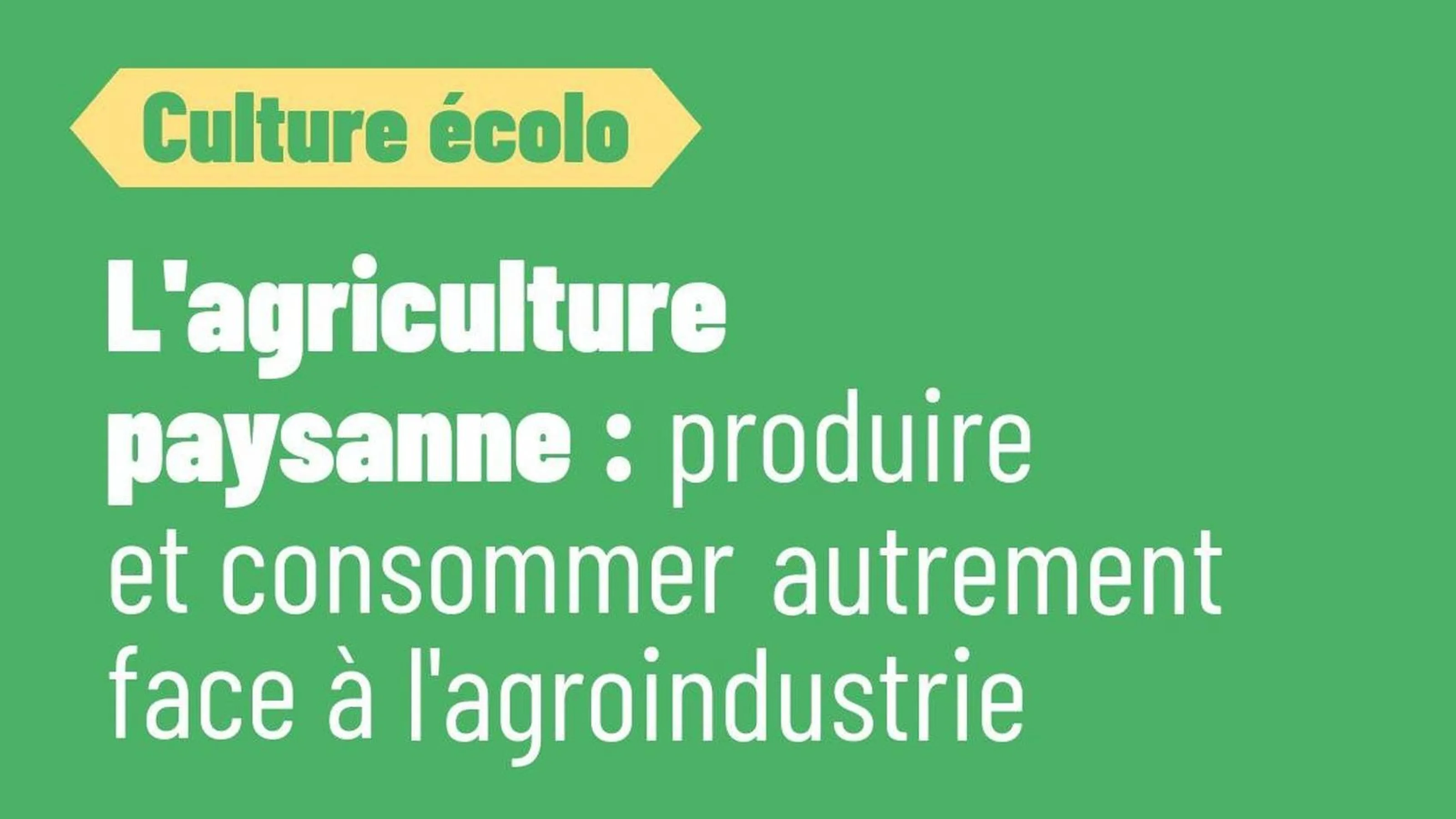
L'expression semble couler de source. "Agriculture paysanne", n'est-ce pas un pléonasme ? Pourtant, la notion a dû être forgée précisément parce qu'elle n'allait plus de soi. Dans un monde agricole remodelé par le productivisme, la concentration foncière, la dépendance aux marchés mondiaux et la mainmise des multinationales, il a fallu nommer ce — ou celles et ceux — qui résistait à l'agro-industrie et à ses faramineux coûts sociaux et environnementaux.
L'agriculture paysanne, c'est une idée politique. Une vision de l'agriculture qui ne se réduit pas à produire des tonnes de denrées standardisées à des prix cassés, mais qui reconnaît à l'agriculture un rôle social, environnemental et culturel. Elle façonne les paysages, tisse les liens entre générations, irrigue les circuits de solidarité, fait vivre les territoires et préserve l'environnement du déclin massif de biodiversité imputable à l'agro-industrie.
✊ Apparue en France dans les années 1990 sous l'impulsion de la Confédération paysanne, puis théorisée par la FADEAR, l'agriculture paysanne s'est peu à peu constituée comme un contre-modèle face à l'agro-industrie dominante. Elle s'appuie sur une charte, dix principes (autonomie, solidarité, diversité, transparence, répartition…), et six grands axes pour des fermes durables, transmissibles, et ancrées dans les territoires.
Cette conceptualisation n'a rien d'une coquetterie intellectuelle. Elle répond à l'urgence de penser les liens entre pratiques agricoles et projet de société — dans un contexte où l'agro-industrie, à force de marketing, a colonisé les imaginaires et effacé les mémoires rurales.
📚 En France, l'enracinement de l'agro-industrie s'est fait au prix de violences multiples, de restructurations brutales, d'un arrachage systématique du monde d'avant. Elle trouve l'un de ses moments les plus marquants dans le remembrement rural, lancé après-guerre au nom de la modernisation. En regroupant les parcelles, en rasant les haies, en nivelant les talus à coups de bulldozers, l'État a ouvert la voie à une agriculture mécanisée, chimique et principalement tournée vers l'export.
🔍 En Touraine, comme ailleurs, cette transformation a sacrifié des élevages, fait disparaître des paysages bocagers, et avec eux des savoir-faire, des métiers et des liens. Tandis que de nombreux villages se vidaient ou se périurbanisaient au milieu de champs de plus en plus mécanisés, seuls les espaces viticoles semblent aujourd'hui témoigner d'une ruralité à peu près préservée. Le "terroir" a été muséifié — réduit à ses produits stars : vin, fromage — tandis que la vie rurale, elle, était profondément bouleversée.
👉 La BD "Champs de bataille" d'Inès Léraud et Pierre Van Hove restitue cette violence oubliée : familles fracturées, paysans criminalisés, mémoire traumatique encore vive dans les campagnes. Une modernisation autoritaire, parfois imposée sous escorte policière, que les archives révèlent aujourd'hui dans toute sa brutalité.
Ce que ce modèle industriel a gagné en rendement, il l'a perdu en lien social, en biodiversité, en santé publique. On a sacrifié les haies, les modes de vie, les écosystèmes… Et le saccage continue : 20 000 kilomètres de haies disparaissent encore chaque année.
🌱 L'agriculture paysanne, elle, trace une autre voie :
— des fermes à taille humaine, transmissibles, à forte densité d'emplois ;
— une autonomie renforcée : semences libres, circuits courts, autofinancement ;
— un respect du vivant : agroécologie, polyculture, biodiversité cultivée ;
— une solidarité active : coopération locale, développement rural, souveraineté alimentaire.
Ce modèle n'est ni folklorique ni marginal ; on le retrouve dans les AMAP, les paysans-boulangers, les coopératives de transformation, les marchés bio, et les luttes contre les méga-bassines, les fermes-usines, ou l'accaparement des terres. Tout l'inverse du modèle toxique promu par la loi Duplomb et ses soutiens.
🌍 À l'échelle mondiale, il est porté par le mouvement La Via Campesina, qui rassemble plus de 180 organisations paysannes. Cette coordination internationale lutte pour les droits des paysans, la réforme agraire, l'agroécologie, la préservation des semences, la souveraineté alimentaire, face aux politiques commerciales qui sacrifient les agricultures vivrières au profit du libre-échange et des multinationales.
🧭 Revaloriser l'agriculture paysanne, c'est refuser une agriculture hors-sol, financiarisée, déshumanisée. C'est repolitiser notre rapport à la terre, au travail, à l'alimentation. C'est une bataille pour la démocratie, la justice sociale et la dignité des paysan·nes qui nourrissent le monde.




