Le droit à la ville : pour une ville vivable, pour toutes et tous
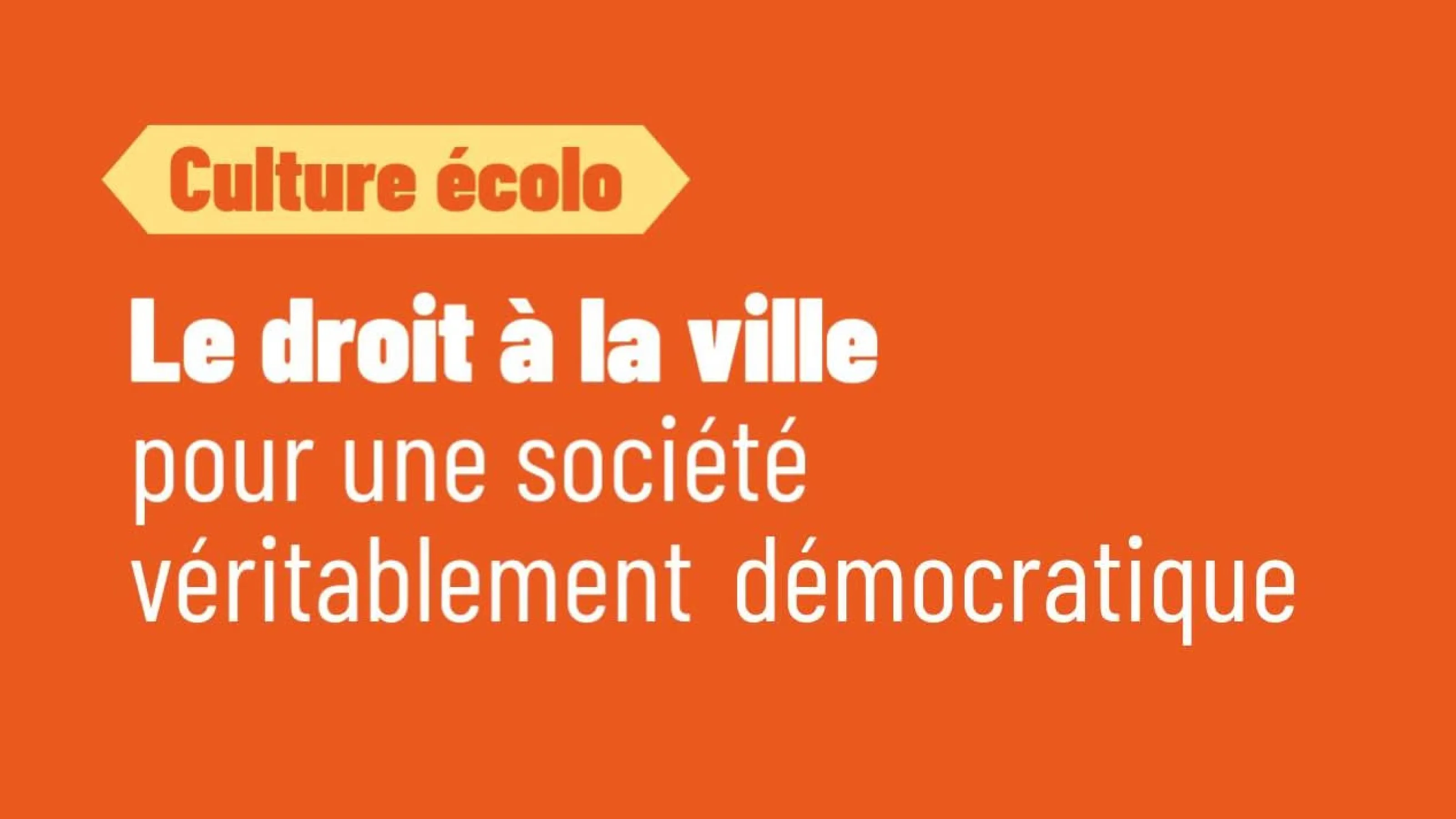
Le droit à la ville est une exigence démocratique. C'est le droit de vivre pleinement la ville : d'y habiter dignement, d'y circuler librement, d'y rester, de s'y exprimer, d'y créer du commun.
📚 Théorisé dès 1968 par Henri Lefebvre, ce droit est d'abord un refus : refus de laisser la fabrique de la ville aux seuls intérêts privés, refus d'un urbanisme imposé par un pouvoir vertical, sourd aux aspirations des habitant·es. Il naît dans un contexte d'expulsions massives des classes populaires des centres urbains, sous l'effet de la spéculation, de la gentrification et d'un aménagement conçu sans, voire contre, les populations.
Mais c'est aussi une aspiration : repenser la ville comme un bien commun. Une ville que l'on ne se contente pas de traverser ou de consommer, mais que l'on façonne collectivement. Une ville que l'on habite en y participant pleinement — en décidant, en débattant, en créant des lieux, des usages, des solidarités.
🌍 Le droit à la ville s'incarne dans le droit à l'espace public. Un espace réellement partagé, accessible à toutes et tous : enfants, femmes, personnes âgées, racisé·es, personnes précaires, personnes en situation de handicap. C'est là que se joue une lutte silencieuse mais décisive contre l'ordre social établi : penser l'espace public autrement, c'est penser la société autrement. Refuser l'aseptisation, reconnaître les conflictualités, faire place à l'imprévu : c'est une démarche profondément politique, pour mieux faire société. Le droit à la ville implique d'accepter que l'espace public soit un lieu de contestation des pouvoirs, où le droit de manifester y est sanctuarisé.
🚷 Dans de nombreuses villes, pourtant, l'espace public se transforme au détriment de sa vocation universelle. Ici, des bancs sont supprimés. Là, des arrêtés anti-mendicité se multiplient. Ailleurs, des dispositifs "anti-indésirables" redéfinissent qui peut ou non occuper l'espace. L'accès libre, sans but marchand, devient une exception. Dormir dehors est criminalisé, flâner devient suspect. On ne fait plus place à l'habitant·e, mais au consommateur rentable.
🛑 Cette privatisation rampante — parfois insidieuse, parfois assumée — fragmente la ville. Zones commerciales sécurisées, lotissements fermés (gated communities), mobilier urbain dissuasif, gestion déléguée à des acteurs privés… autant de pratiques qui dessinent une ville triée, filtrée, surveillée. Ce ne sont pas toutes les villes, mais ce sont des tendances bien réelles.
🔍 Le confinement a servi de révélateur. Il a mis en lumière les inégalités d'accès à l'espace, la brutalité du mal-logement, la violence d'un urbanisme qui confine certains à l'inconfort, à l'isolement ou à l'invisibilité. Il a aussi rappelé la valeur de la proximité et la nécessité d'un accès universel à la nature, aux services, aux équipements de quartier. Il a ravivé les enjeux de mobilité sobre, de ville du quart d'heure, de ville polycentrique.
🎯 Pour les écologistes, défendre le droit à la ville, c'est :
– garantir un accès égal et libre à l'espace public, indépendamment de l'âge, du genre, de l'origine ou du statut social ; – lutter contre la ségrégation spatiale et la spéculation foncière ;
– refuser la ville fonctionnelle qui assigne chacun à un lieu unique (dormir ici, travailler là, consommer ailleurs), et revaloriser des centralités locales vivantes ;
– affirmer que le droit à la ville, c'est aussi le droit à un logement digne, à des transports publics accessibles, à des espaces pour se poser, se rencontrer, s'exprimer.
⚠️ Cela suppose aussi de repenser nos outils de participation, de refuser les dispositifs qui n'impliquent que les plus favorisés ou les plus diplômés, de construire une véritable citoyenneté habitante, inclusive, continue, réelle. Sans cela, on ne ferait que déplacer l'exclusion.
✊ Le droit à la ville, c'est le droit d'être là. Sans avoir à consommer. Sans avoir à se justifier. Sans avoir à prouver qu'on le mérite. C'est un droit à la proximité, à la lenteur, à l'anonymat aussi. Et c'est, profondément, un projet écologique, social, féministe et démocratique.




